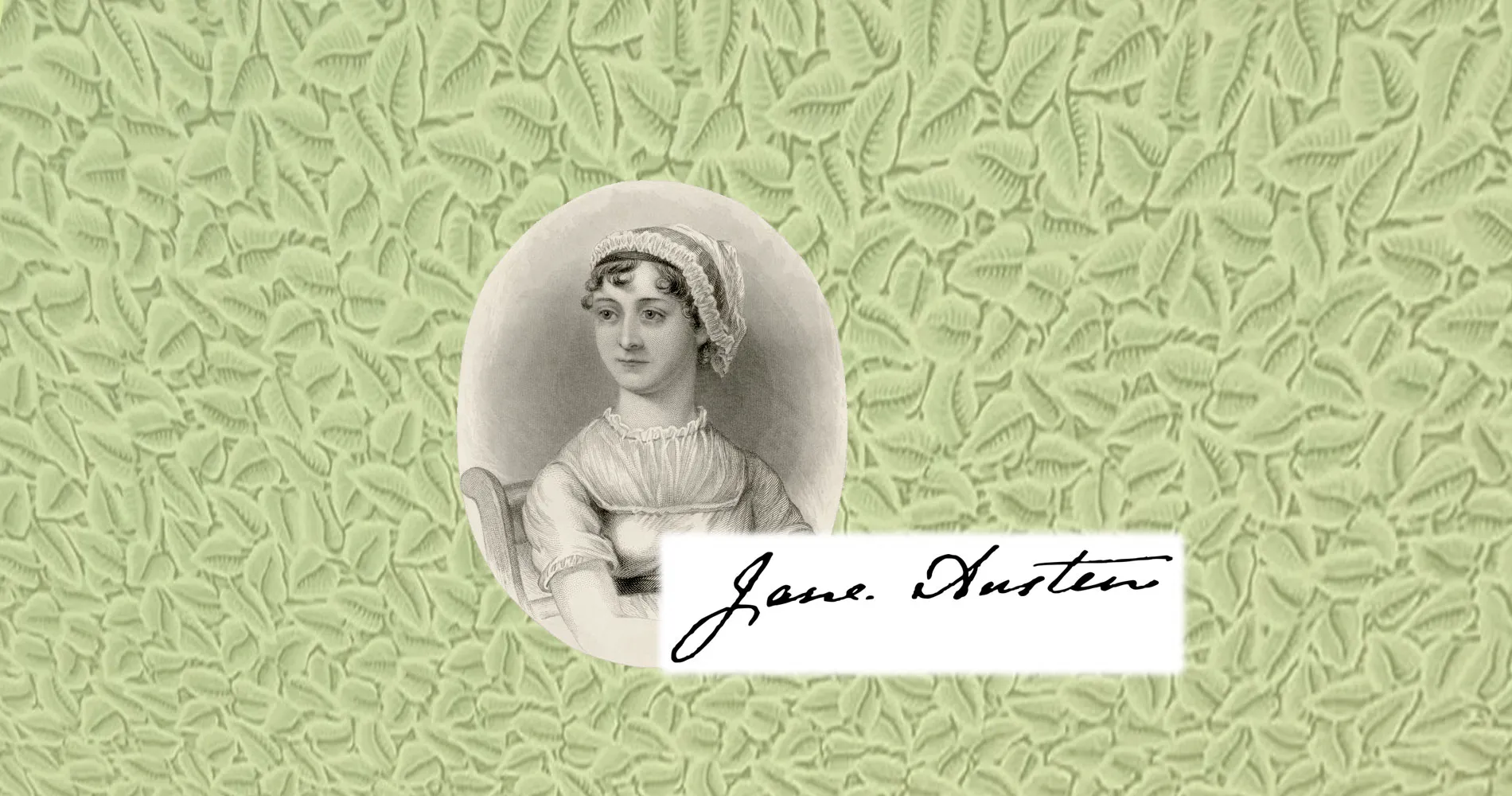La question de ce qui lie les sociétés humaines intrigue les penseurs et les historiens depuis des siècles. Si l’humanité est, comme on le suppose souvent, une espèce motivée par l’intérêt personnel, comment des communautés d’individus, chacun animé par ses ambitions personnelles, peuvent-elles prospérer, voire perdurer ? Cette question a été traitée de manière convaincante par Abdul Rahman Ibn Khaldun, historien, économiste et sociologue arabe musulman pionnier du XIVe siècle. Ses réflexions intemporelles sur la cohésion sociale ou Asabiyyah restent remarquablement pertinentes aujourd’hui, contrastant fortement avec l’éthique individualiste souvent célébrée dans les sociétés occidentales.
Aly Mahmoud
21 août 2024
Chinese version | English version | Spanish version
Les nombreux voyages d’Ibn Khaldoun à travers le Maghreb, notamment au Maroc, à Grenade, en Tunisie et au Caire, lui ont permis d’acquérir une perspective diversifiée sur la dynamique humaine. Au cours de sa vie, il a occupé diverses fonctions, notamment celles de juge, d’homme d’État et de diplomate. Son ouvrage fondateur, Kitab al-Ibar, en particulier son introduction, Muqaddimah (prolégomènes en arabe), est devenu un classique et est considéré comme un document fondateur dans divers domaines de la recherche humaine, en particulier les sciences sociales. Un élément clé de l’œuvre d’Ibn Khaldoun est le groupe, et non l’individu, qui était le point central et le facteur déterminant de l’histoire. Cette perspective contraste avec l’approche centrée sur l’individu ou l’Id qui prévaut en Occident, en particulier depuis la Renaissance des XIVe et XVe siècles.
Ibn Khaldoun considérait les êtres humains comme intrinsèquement dominateurs et compétitifs, animés par un désir de pouvoir qui aboutit souvent à des conflits. Il décrivait les individus comme « sauvages, stupides, faibles et ignorants », ce qui l’a incité à explorer comment ces tendances égoïstes pouvaient se transformer en sociétés cohésives. Sa réponse réside dans le concept d’Asabiyyah.
Le concept d’Asabiyyah, qui dérive de la racine arabe « Asab », signifiant « lier » ou « unir », a pris de l’importance grâce aux travaux d’Ibn Khaldoun et a été interprété de différentes manières par les chercheurs. Bien qu’il soit souvent assimilé à la cohésion sociale, à l’esprit de corps, à la solidarité ou même au nationalisme, ces comparaisons peuvent être trompeuses. Contrairement aux cadres rigides associés au patriotisme ou au nationalisme absolu, l’Asabiyyah apparaît comme une force multiforme et dynamique. Elle incarne le soutien mutuel, le respect et un engagement collectif en faveur du bien-être social, résumant ainsi l’essence même de la vie communautaire, ou du lien social. Il est important de noter que le concept d’Asabiyyah d’Ibn Khaldoun ne repose pas sur la biologie ou l’ethnicité, mais plutôt sur l’unité fonctionnelle.
Dans ses écrits, Ibn Khaldoun explique que lorsqu’un groupe a peu de liens du sang, il se développe un sentiment naturel d’unité appelé « Asabiyyah ». Cependant, à mesure que le groupe s’agrandit et que les liens du sang s’affaiblissent, ce sentiment d’unité devient davantage une illusion. Selon Ibn Khaldoun, ce ne sont pas les liens du sang qui importent, mais la croyance en ceux-ci et le sentiment de proximité et de soutien mutuel qui en résulte.
Khaldoun a examiné la dynamique des relations au sein des groupes et a démontré comment les sentiments collectifs contribuent à l’émergence de nouvelles civilisations et d’une nouvelle autorité politique, pour ensuite s’affaiblir avec le temps. Il a formulé une théorie cyclique basée sur l’Asabiyyah, associée à une ferveur que l’on retrouve chez ceux qui vivent en marge des grandes civilisations. Ces groupes, dotés d’une force et d’une vigueur qui transcendaient souvent leur taille numérique, étaient capables de conquérir des villes plus avancées et plus riches. Cependant, les vainqueurs ont fini par succomber au confort de la civilisation, ce qui les a rendus vulnérables aux conquêtes ultérieures de groupes dotés d’une Asabiyyah plus forte.
Khaldun affirme que « les êtres humains ont besoin d’une personne qui joue le rôle de modérateur et de médiateur dans toute organisation sociale afin d’empêcher les membres de se battre entre eux ». Ce médiateur doit posséder un certain degré de supériorité en matière d’Asabiyyah, une autorité qui est corrélée au pouvoir politique. Si la force militaire peut établir l’autorité royale, c’est l’Asabiyyah qui agit comme le lien essentiel unissant les sociétés, s’avérant plus puissante dans les environnements tribaux que dans les environnements urbains.
Un leadership efficace joue un rôle crucial dans le développement et le maintien de l’asabiyyah. Un leader respecté qui incarne les valeurs communes de la communauté peut cultiver la loyauté et l’obéissance en alignant son leadership sur les aspirations de la société. De plus, des objectifs communs, des expériences partagées et des normes collectives renforcent encore le sentiment d’asabiyyah. Ibn Khaldoun explique en outre que lorsque les individus perçoivent leurs luttes comme servant les intérêts d’un roi lointain, d’un clan extérieur ou d’une abstraction plutôt que ceux de leur propre communauté, l’asabiyyah s’affaiblit, compromettant ainsi la stabilité de la communauté.
Ibn Khaldoun estimait qu’un certain nombre de facteurs pouvaient conduire à la perte de l’asabiyyah. L’un d’entre eux est l’augmentation de la richesse et du luxe, qui réduit souvent la nécessité d’une action collective et incite les individus à privilégier leur intérêt personnel au détriment du bien-être communautaire, un phénomène de plus en plus observable aujourd’hui à mesure que les disparités économiques se creusent. Les plus riches peuvent se soustraire à leurs responsabilités sociales, laissant les populations vulnérables faire face seules à des difficultés croissantes. Sur le plan moral, le luxe s’avère destructeur, incitant les individus à privilégier le confort matériel au détriment des considérations éthiques. Ces changements culturels alimentent la malhonnêteté et l’égoïsme, affaiblissant finalement l’asabiyyah et rendant les sociétés vulnérables aux menaces extérieures, l’individualisme et le factionnalisme éclipsant la force collective.
De plus, Ibn Khaldoun met en garde contre le fait que la corruption politique et la montée du fanatisme peuvent diviser les sociétés en factions rivales, sapant ainsi la solidarité. Lorsque le sentiment d’Asabiyyah d’une société s’affaiblit, celle-ci devient vulnérable à la rhétorique divisionniste et à l’instabilité identitaire, ce qui conduit à un éloignement des aspirations collectives. L’affirmation de Khaldoun selon laquelle un leadership efficace repose sur le maintien de l’asabiyyah souligne la nécessité pour les dirigeants de travailler avec diligence pour unir les communautés et lutter contre l’érosion de la confiance.
Au fil du temps, la complaisance peut s’installer dans les sociétés qui se sont habituées à la facilité et au confort. La résilience et la ténacité indispensables pour faire face aux défis peuvent s’amenuiser, en particulier chez les jeunes générations qui n’ont peut-être pas connu l’adversité. Ce risque souligne la nécessité pour les communautés de cultiver la résilience et l’adaptabilité, en promouvant une culture où les individus se sentent concernés par la réussite du collectif.
Alors que les sociétés naviguent dans les complexités de la vie moderne, marquée par la fragmentation et la méfiance, les idées de Khaldoun nous incitent à renouer avec l’esprit de l’asabiyyah. Mettre l’accent sur l’identité collective et le soutien mutuel peut aider à contrer les effets isolants de l’individualisme extrême qui prévaut aujourd’hui.
Bien que les observations d’Ibn Khaldoun aient été ancrées dans les sociétés arabes de son époque, les principes qu’il a énoncés concernant l’Asabiyyah trouvent un écho profond dans le monde d’aujourd’hui. Ses réflexions soulignent que la solidarité de groupe et les liens sociaux sont fondamentaux pour l’ascension et le déclin des civilisations, ainsi que pour les débats contemporains sur la cohésion sociale et la résilience communautaire. En tirant les leçons de l’asabiyyah, les sociétés peuvent relever les défis collectivement, renforçant ainsi la conviction que la véritable force ne réside pas dans l’intérêt personnel, mais dans les liens tissés avec les communautés.
La sagesse intemporelle de l’asabiyyah sert de guide essentiel pour naviguer entre les factions divisées de la vie moderne, soulignant que la solidarité communautaire est indispensable pour faire face à la fois aux menaces extérieures et aux divisions internes. Dans un monde dominé par des récits fragmentés et des interprétations extrêmes de l’individualisme, il devient essentiel de comprendre l’importance de l’empathie et de l’engagement coopératif. La revitalisation de l’Asabiyyah soutient ceux qui s’unissent contre la corruption et l’injustice tout en transformant les intérêts personnels en demandes collectives de changement afin de parvenir à la responsabilité sociale et à la connectivité de l’Asabiyyah.
Photo : Statue d’Ibn Khaldoun à l’entrée de la Kasbah (9.5.2022) © IMAGO / Depositphotos et dôme et minarets de la mosquée Ibn Khaldoun à Alexandrie, en Égypte (17.11.2022) © IMAGO / UIG
Autres Articles
L’ère de la solitude et de la perte des liens sociaux