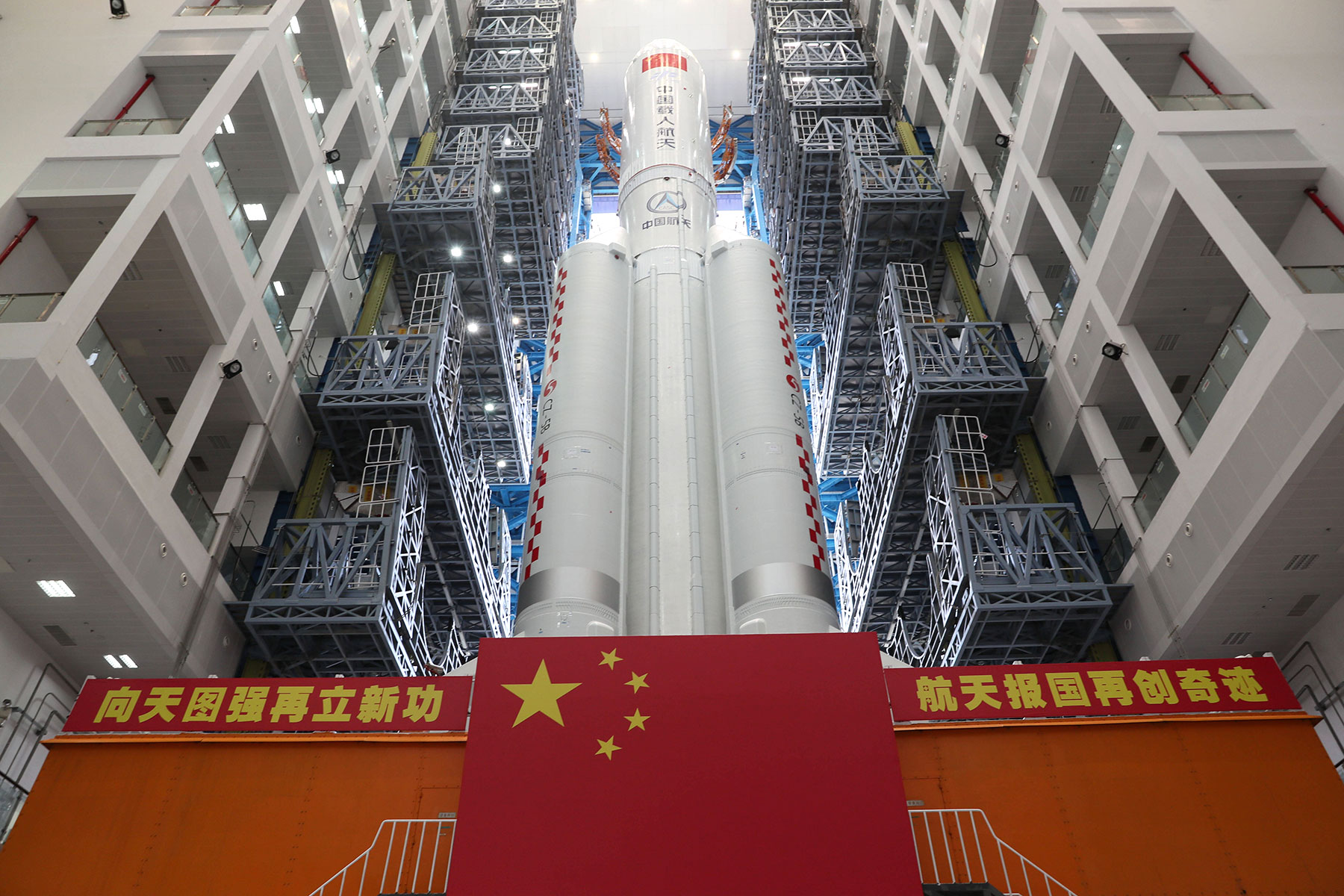Les États-Unis négocient un accord sur les terres rares avec la RDC. Depuis que la guerre commerciale avec la Chine a restreint l’accès des États-Unis à l’approvisionnement en terres rares de la Chine, les États-Unis explorent d’autres sources pour ces minéraux vitaux. L’accord sur les terres rares avec l’Ukraine ne s’est pas encore concrétisé et le président Trump a chargé son conseiller principal pour l’Afrique, Massad Boulos, de conclure l’accord avec la RDC.
Michael Thake
30 avril 2025
Chinese version | English version | German version
Le conflit en République démocratique du Congo (RDC), riche en minerais, s’est accéléré depuis janvier 2025. Le groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda, s’est emparé des villes de Goma et Bukavu lors d’une offensive rapide, faisant au moins 7 000 morts parmi les civils et déplaçant des milliers de personnes. Le contrôle du gouvernement de la RDC sur des provinces minières clés est menacé.
Le conseiller principal du président Donald Trump pour l’Afrique, Massad Boulos, a récemment fait une déclaration optimiste concernant un accord sur les minerais : « Vous avez entendu parler d’un accord sur les minerais. Nous avons examiné la proposition du Congo. Je suis heureux d’annoncer que le président et moi-même nous sommes mis d’accord sur la voie à suivre pour son développement. » Dans le cadre d’un tel accord, les entreprises américaines de défense et de technologie auraient accès aux réserves congolaises de cobalt, de lithium et de cuivre. En retour, les États-Unis offriraient une formation et des équipements militaires – peut-être même des troupes – pour aider à reprendre les zones tenues par les rebelles.
Les États-Unis dépendent fortement de la Chine pour les ressources qui sous-tendent leur économie et leur sécurité nationale. La guerre commerciale actuelle avec la Chine a accentué ce problème. Un accord avec la RDC pourrait faire pencher la balance, s’il est mis en œuvre de manière judicieuse. D’un point de vue stratégique, un accord avec la RDC est logique. Les États-Unis doivent réduire leur dépendance à l’égard de la Chine pour les minerais essentiels, sous peine d’être distancés dans les domaines de la défense, de la fabrication et de l’énergie propre. Mais la voie à suivre est étroite et pleine de risques. Pour réussir, Washington doit placer la transparence et la réforme de la gouvernance au cœur de l’accord, se coordonner avec ses alliés – comme l’UE -, éviter de surmilitariser le partenariat, ce qui pourrait se retourner contre lui, et soutenir une réforme institutionnelle à long terme, et pas seulement l’extraction de ressources à court terme. L’inaction renforcerait le quasi-monopole de la Chine et rendrait les États-Unis vulnérables à la coercition économique.
L’accord proposé a ravivé une question géopolitique pressante : Les États-Unis peuvent-ils encore contrer la mainmise de la Chine sur les richesses minérales essentielles de l’Afrique, ou est-il déjà trop tard ? Actuellement, les richesses minières de la RDC sont principalement dominées par des entreprises chinoises.
Pékin et Washington sont tous deux à la recherche de matières premières essentielles à la fabrication de produits, allant des technologies vertes à la fabrication d’armes. Le rapport « Minerals for Climate Action » (2020) de la Banque mondiale estime que la demande de minéraux critiques tels que le cobalt, le lithium et le graphite augmentera de 500 % entre 2018 et 2050.
Les États-Unis ne disposent pas de ressources nationales suffisantes en cobalt et l’ouverture de nouvelles mines dans le pays prend des années, voire des décennies. La Chine, en revanche, a commencé à obtenir des droits miniers et à investir dans des projets d’infrastructure à travers l’Afrique, via l’initiative « Belt and Road », au cours des deux dernières décennies. Jusqu’à présent, les États-Unis ont été absents de la diplomatie minière africaine et la Chine a été autorisée à étendre son influence sur le continent.
La Chine a dépensé 21,7 milliards d’USD en Afrique en 2023, dont environ 10 milliards d’USD pour les minéraux essentiels. Les États-Unis, en revanche, n’ont investi que 7,4 milliards d’USD, dont 300 millions d’USD seulement ont été consacrés au développement du secteur minier. Le US Select Committee on China (2024) a également constaté que la Chine fournit plus de 50 % de la demande américaine pour 24 minéraux critiques, et 90 % de ses éléments de terres rares.
La domination de la Chine est le fruit de décennies de planification et d’une politique industrielle dirigée par l’État. Pékin contrôle non seulement l’extraction à grande échelle, mais aussi le raffinage et la transformation en aval, établissant ainsi une relation symbiotique, voire codépendante, avec la RDC. En revanche, les États-Unis se sont largement appuyés sur des partenariats avec le secteur privé dans leurs relations avec les pays africains, incluant généralement une pléthore d’acteurs du secteur privé local, des formalités administratives considérables et des normes environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), nécessitant des réformes plus lourdes que les accords présentés par la Chine.
L’accord proposé pour la RDC pourrait permettre à l’Amérique de faire une percée. Il permettrait de diversifier les chaînes d’approvisionnement, de réduire la dépendance à l’égard de la Chine et de renforcer les entreprises américaines dans les secteurs des batteries, de l’énergie solaire et de la défense. La RDC pourrait également s’aligner sur les partenaires occidentaux, améliorant potentiellement les normes de travail et d’environnement, dont les habitants se plaignent depuis longtemps du traitement et des pratiques malveillantes de la Chine. Mais le succès est loin d’être garanti et le contrôle américain a déjà subi des revers, comme avec l’acquisition de la plus grande mine de cobalt au monde en RDC, par la China Molybdenum Compand (CMOC) de la société américaine Freeport-McMoRan en 2016.
L’engagement des États-Unis en RDC pourrait alimenter des réformes positives et contribuer à lutter contre la corruption, qui gangrène depuis longtemps le secteur minier congolais. La transparence des contrats, le partage des bénéfices avec les communautés et les garanties environnementales sont essentiels. En outre, la lutte contre le travail des enfants est depuis longtemps un problème dans les projets miniers en RDC.
Le précédent mandat de Trump a révélé un manque d’intérêt pour l’Afrique au-delà des équilibres commerciaux et de la lutte contre le terrorisme. Sa deuxième administration semble davantage axée sur la « concurrence entre grandes puissances », tout en restant sceptique à l’égard de l’engagement multilatéral. En outre, avec la récente mise en œuvre par Trump de tarifs douaniers, en particulier contre la Chine, la recherche de sources alternatives pour les minéraux de terres rares est une priorité absolue pour le président américain.
Le conseiller principal des États-Unis pour l’Afrique, M. Boulos, a affirmé que « les États-Unis restent déterminés à soutenir la fin du conflit ». L’accord sur les minerais « affirmerait l’intégrité territoriale de la RDC ». Pourtant, cet optimisme n’est pas partagé par tous, qui craignent que les entreprises américaines ne deviennent la cible d’extorsions, tandis que l’armée américaine est entraînée dans une guerre civile prolongée. L’implication de l’armée américaine – destinée à sécuriser les lignes d’approvisionnement – risque de refléter les engagements étrangers passés en Irak et en Afghanistan
L’heure tourne. Un accord sur les minerais avec la RDC n’est pas une solution miracle, mais c’est peut-être la dernière et la meilleure chance pour l’Amérique de réécrire les règles des chaînes d’approvisionnement mondiales en minerais.