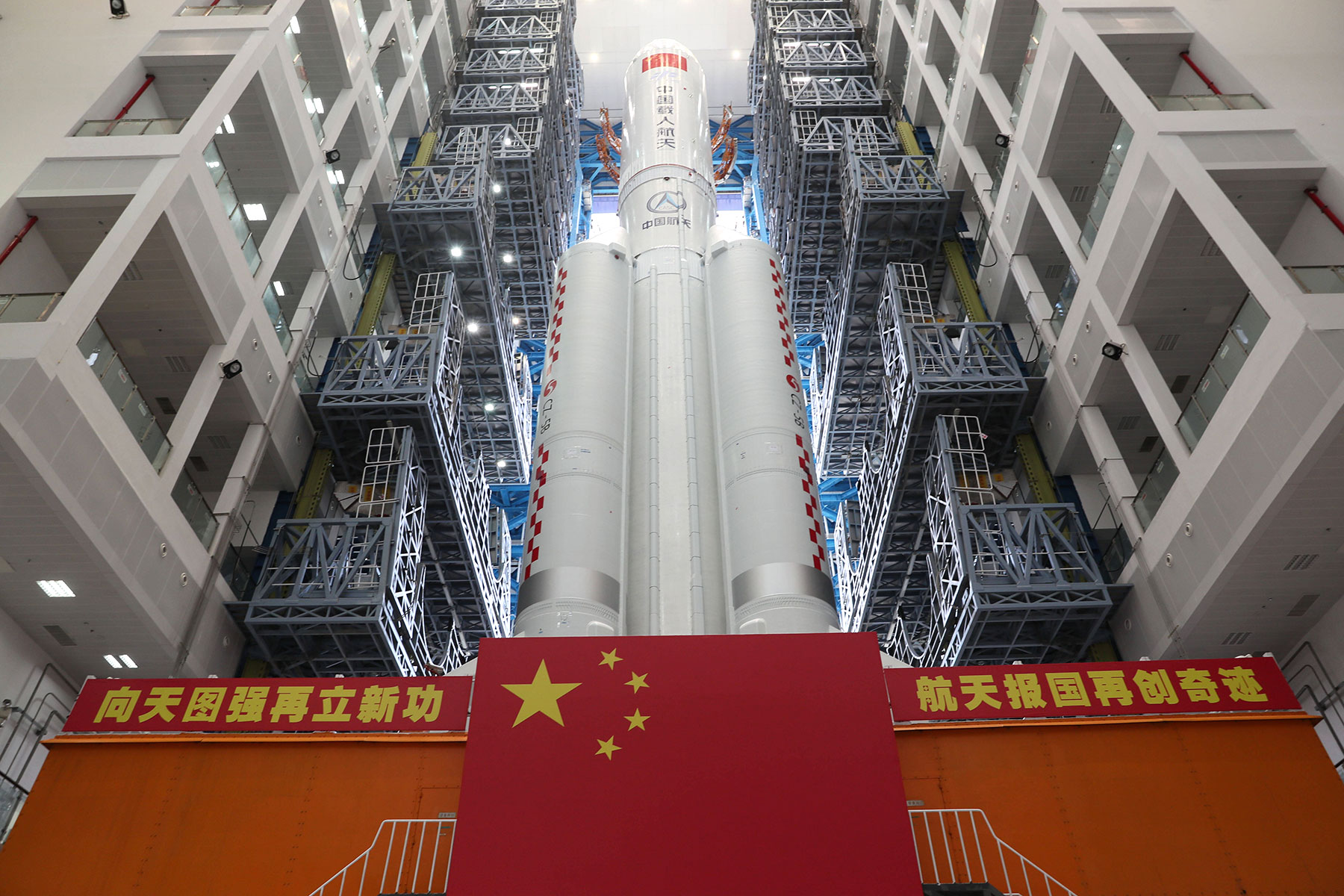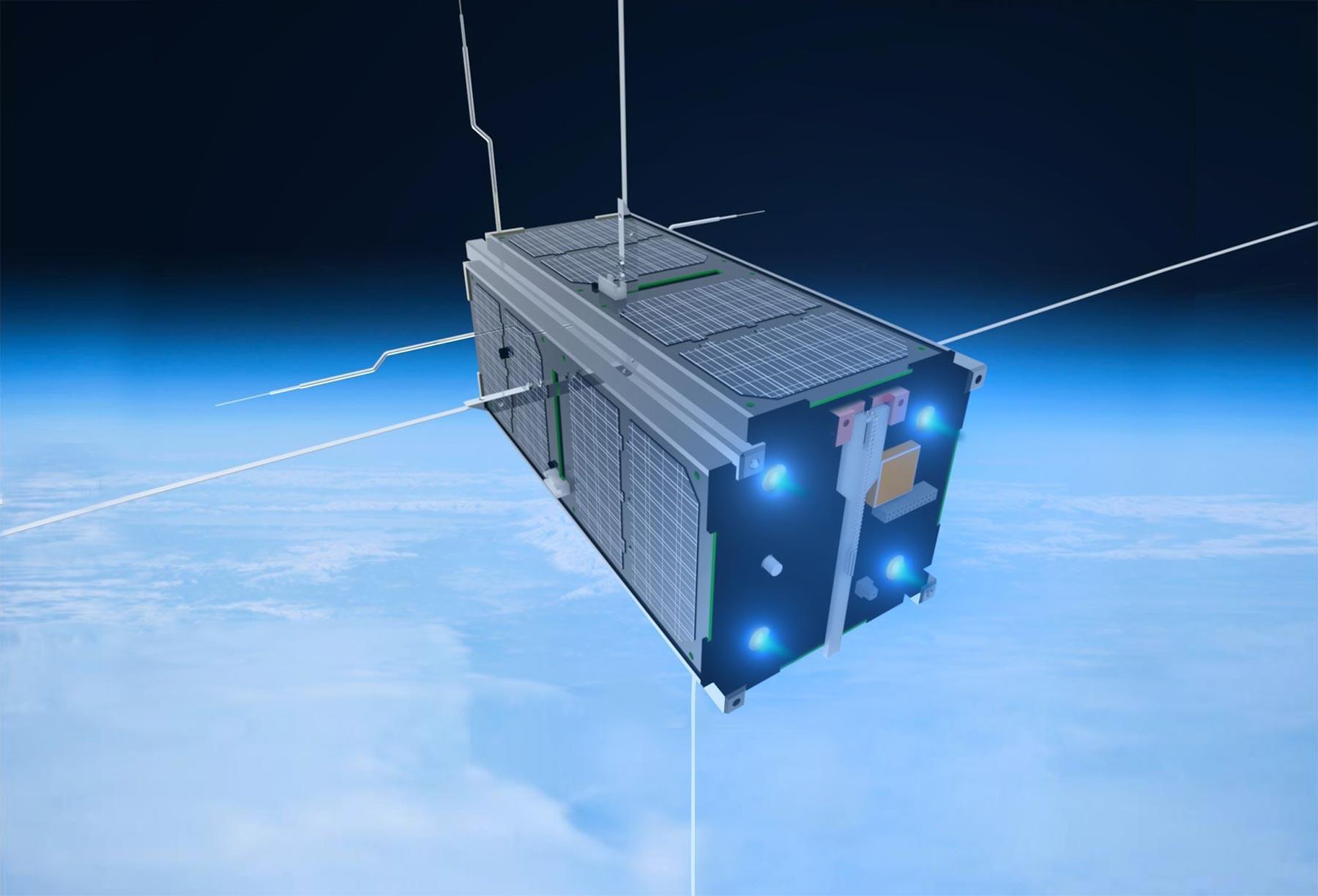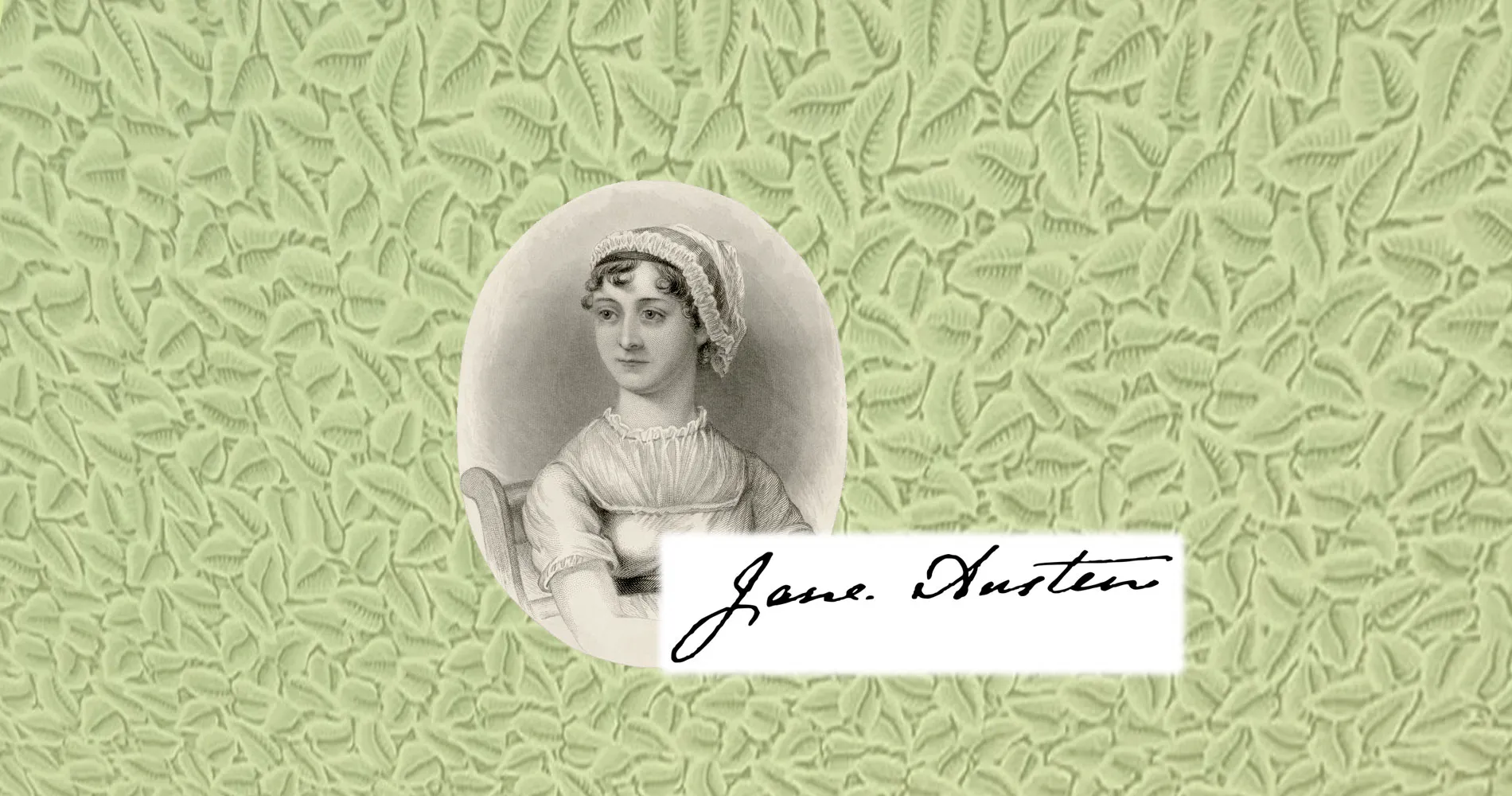Le 15 avril 1945, la ville de Vienne a été libérée des nazis par l’armée soviétique, l’Armée rouge. La bataille de Vienne a fait des dizaines de milliers de victimes et fut le centre d’une résistance interne, d’un recrutement forcé et de violences systématiques contre les civils.
Miriam Eulert
5 mai 2025
English version | German version | Russian version
Au début du mois d’avril 1945, la cathédrale Saint-Étienne est en flammes, les canalisations d’eau ont été détruites, les ponts ont été détruits ou minés, la ville est sans électricité et en grande partie sans administration. La Seconde Guerre mondiale touche à sa fin et a déjà coûté la vie à environ 60 millions de personnes. Avec 27 millions de victimes, l’Union soviétique a subi la plus grande partie des pertes civiles et militaires dans la lutte contre les nazis.
La Grande Guerre patriotique de 1941-1945. Les forces soviétiques combattent pour chasser les envahisseurs allemands de Vienne. Soldats devant le Musée d’histoire naturelle, 05.04.1945. Simon Raskin Vienne Autriche. © IMAGO / SNA
Avec l’aide des résistants, avec lesquels l’Armée rouge était déjà en contact pendant l’entre-deux-guerres, l’Armée rouge libère la ville de Vienne des nazis. Les groupes de résistance comprennent les communistes, les groupes chrétiens conservateurs et également certains officiers autour du major Carl Szokoll dans le commandement militaire du district XVII. Karl Renner, qui deviendra par la suite le premier chancelier autrichien, est mis en sécurité au château d’Eichbüchl avec l’aide des soldats de l’Armée rouge.
La bataille de Vienne a infligé de lourdes pertes aux Soviétiques : 168 000 hommes au total. Les chiffres concernant les pertes de la Wehrmacht allemande lors de la bataille de Vienne varient entre 20 000 et 37 000. Ces pertes élevées sont le résultat d’une bataille urbaine acharnée contre un ennemi invisible qui pouvait tirer depuis n’importe quelle fenêtre de la ville. Baldur von Schirach, gouverneur du Reich à Vienne, ordonna de « se battre jusqu’au dernier homme ».
L’opération débute le 16 mars 1945 et dure jusqu’au 15 avril 1945. À mesure que le front approchait, la violence à l’intérieur s’intensifia. Baldur von Schirach imposa la loi martiale le 30 mars. Les personnes qui fuyaient la guerre étaient abattues. Il suffisait de ne pas se présenter au travail ou de désobéir aux ordres de marche. De nombreux civils périrent à cette époque sous le coup de tribunaux sommaires arbitraires ou de la loi du lynchage. Les crimes commis durant la phase finale constituent un élément central de cette violence. Parmi ceux-ci figurait le meurtre ciblé de travailleurs forcés juifs, qui étaient conduits à travers l’Autriche en longues colonnes. Les groupes originaires de Hongrie, de Pologne et de Slovaquie furent particulièrement touchés. Ils furent contraints de marcher vers Mauthausen, souvent sans nourriture ni chaussures, sous la surveillance de SS qui avaient pour ordre de tirer sur quiconque « restait à la traîne ». Les unités locales ou les civils étaient également souvent contraints par les nazis de prendre les armes. Quiconque donnait de l’eau ou aidait était considéré comme suspect.
 Soldats soviétiques sur le toit de l’hôtel de ville de Vienne, sur lequel flottait le drapeau national autrichien. Haldei Sputnik Vienne Autriche © IMAGO / SNA
Soldats soviétiques sur le toit de l’hôtel de ville de Vienne, sur lequel flottait le drapeau national autrichien. Haldei Sputnik Vienne Autriche © IMAGO / SNA
 Levée d’un drapeau soviétique à Vienne. Simon Raskin Vienne Autriche. © IMAGO / SNA
Levée d’un drapeau soviétique à Vienne. Simon Raskin Vienne Autriche. © IMAGO / SNA
Malgré tout, une résistance s’est manifestée au sein même des forces armées allemandes : sous le nom d’opération Radetzky, certains officiers du Wehrkreiskommando (commandement des forces armées) XVII, dont Carl Szokoll, ont tenté de livrer Vienne aux Soviétiques sans combattre. Il s’agissait d’un plan conspirateur très risqué : il fallait empêcher la destruction des ponts, prendre le contrôle des moyens de communication et permettre une retraite ordonnée afin d’éviter de nouvelles destructions et pertes humaines. Mais avant que le signal ne soit donné pour mettre le plan à exécution, le groupe est trahi. Trois des officiers, Karl Biedermann, Alfred Huth et Rudolf Raschke, sont pendus publiquement le 8 avril. Leurs corps restèrent pendus pendant des heures sur le Stubenring. Szokoll réussit à s’échapper.
Le 13 avril 1945, l’Armée rouge prend Vienne. Pour beaucoup, cela marqua la fin de la guerre. Pour d’autres, ce fut le début d’une période ambivalente, entre libération, contrôlée et nouvelle dépendance. L’occupation, qui dura jusqu’en 1955 dans l’est de l’Autriche, fut caractérisée par le contrôle et la réquisition.
Aujourd’hui, bon nombre de ces lieux ont disparu du paysage urbain. Mais il existe encore des endroits où ils sont visibles, ou du moins où leur souvenir est préservé. L’un d’entre eux se trouve sous terre, dans le 9e arrondissement de Vienne. Ancien abri anti-aérien, il abrite aujourd’hui le Musée de la libération de Vienne 1945-1955, qui retrace les dernières semaines de la guerre. Les visiteurs descendent un escalier étroit et froid. Au-dessus de l’entrée, une pancarte en cyrillique indique que ce bunker a été fouillé par les soldats soviétiques. Ils y cherchaient des soldats nazis et des membres du parti. Ils y ont trouvé de l’alcool.
Impressions du Musée de la libération de Vienne 1945-1955 par Miriam Eulert © iGlobenews
Les pièces sont petites et sans lumière naturelle. Jusqu’à récemment, on pensait qu’environ 10 personnes étaient logées dans une pièce, comme le montre l’image, mais en réalité, elles étaient probablement plutôt 30 ou 40. L’espace était si exigu que beaucoup de personnes ne pouvaient pas atteindre les toilettes à temps. Certaines pièces étaient utilisées pour les soins médicaux – invalides de guerre, blessés, malades. L’air est froid, l’exiguïté oppressante. Aussi précaires que fussent les conditions dans les bunkers, seuls quelques chanceux y étaient hébergés. La majorité de la population n’avait pas de place et devait attendre dans leurs caves.
En mémoire des 17 000 victimes de l’Armée rouge tombées lors de la bataille de Vienne, le monument aux héros de l’Armée rouge a été érigé sur la Schwarzenbergplatz, au centre de Vienne. Plus que tout autre mémorial à Vienne, le monument russe commémore la libération de la dictature nazie et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce mémorial et d’autres monuments similaires ont été stipulés par les puissances alliées dans l’article 19 du traité d’État autrichien.